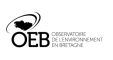Les usages des pesticides induisent une contamination de tout l'environnement (air, eau sol), avec des mécanismes de dispersion complexes et des impacts sur la santé et les milieux. Une fois dispersés dans l’environnement, les pesticides peuvent affecter d’autres espèces que celles visées par les traitements et venir altérer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, posant des problèmes notamment pour la production d’eau potable et la vie aquatique. Les pesticides font l'objet de suivis dans les cours d'eau en Bretagne afin d'évaluer la situation en matière de respect des limites règlementaires sanitaires (eau brute et eau distribuée) ou d'impact écologique (respect des NQE ou des PNEC).
Cette datavisualisation propose une analyse interactive des données relatives aux suivis des pesticides en eau de surface, aux échelles géographiques pertinentes. Différentes synthèses sont proposées :
- une analyse de l'impact sanitaire des pesticides mesurés dans les cours d'eau bretons
- une analyse de l'impact écologique des pesticides mesurés dans les cours d'eau bretons en lien avec la DCE (substances avec NQE)
- une analyse de l'impact écologique des pesticides mesurés dans les cours d'eau bretons (substances avec PNEC)
Les différents éléments graphiques proposent des informations complémentaires lors de survol avec la souris (info bulle) ou des zones cliquables qui permettent d'affiner les résultats proposés.
Métadonnées
- Sources des données
-
Les données traitées proviennent de :
- AFB : export de la base de données Naiades (via Hub'eau), plateforme d’accès aux données brutes sur la qualité des eaux de surface ;
- DREAL : export de la BD Lyxea / BEA (suivis qualité complémentaires effectués dans le cadre des contrats de territoire) et de la BD CORPEP ;
- AELB : export de la base de données OSUR, plateforme d’accès aux données brutes de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Les exports sont réalisés sur l’ensemble des données disponibles depuis 01/01/2000, tous dispositifs de collecte confondus. Le traitement des doublons de bancarisation est géré par l’OEB.
L'intégralité de l'historique des données est reprise à chaque mise à jour, afin que les résultats proposés dans les tableaux de bord intègrent les corrections apportées par les producteurs dans la base de données. Des évolutions dans l'historique des résultats sont donc possibles d'une année sur l'autre. - Traitement des données
-
Impacts sanitaires - Dépassement des seuils fixés pour l’AEP
Seules les analyses quantifiées (dont le résultat est supérieur au seuil de quantification - Remarque analyse 1) sont prises en compte pour le calcul du respect des limites règlementaires sanitaires.
- Seuils de restitution par station :
- Rouge - Dépassement des seuils 2 μg/l (max) et/ou 5 μg/l (somme)
- Concentration > 2 μg/l au moins une fois dans l'année toutes substances confondues
- Et/ou somme des concentrations des différentes substances quantifiées présentes simultanément (dans un même prélèvement) > 5 μg/l
- Orange - Dépassement des seuils 0,1 μg/l (max) et/ou 0,5 μg/l (somme)
- Concentration > 0,1 μg/l au moins une fois dans l'année toutes substances confondues
- Et/ou somme des concentrations des différentes substances quantifiées présentes simultanément (dans un même prélèvement) > 0,5 μg/l
- Vert - Pas de dépassement
- Concentration ≤ 0,1 μg/l toutes substances confondues
- Et somme des concentrations des différentes substances quantifiées présentes simultanément (dans un même prélèvement) ≤ 0,5 μg/l
- Rouge - Dépassement des seuils 2 μg/l (max) et/ou 5 μg/l (somme)
- Seuil de restitution des concentrations maximales par substance (par station):
- Rouge - Concentration > 2 μg/l au moins une fois dans l'année
- Orange - Concentration > 0,1 μg/l au moins une fois dans l'année
- Vert - Concentration ≤ 0,1 μg/l
- Seuil de restitution de la somme des concentrations de substances quantifiées simultanément dans l’eau (par prélèvement) :
- Rouge - Somme des concentrations des différentes substances quantifiées présentes simultanément (dans un même prélèvement) > 5 μg/l
- Orange - Somme des concentrations des différentes substances quantifiées présentes simultanément (dans un même prélèvement) > 0,5 μg/l
- Vert - Somme des concentrations des différentes substances quantifiées présentes simultanément (dans un même prélèvement) ≤ 0,5 μg/l
Impacts écologiques - Respect des NQE ou des PNEC
Pour ces traitements, les analyses bancarisées sous un code remarque anlayse 1 (Résultat > seuil de quantification et < au seuil de saturation), 7 (Traces < seuil de quantification et > seuil de détection) et 10 (Résultat < au seuil de quantification) sont considérées. Lorsque la limite de quantification n’est pas renseignée, elle est remplacée par :
- le résultat pour l’analyse dont le code remarque est égal à 10 ou 7
- et par 0 pour l’analyse dont le code remarque est égal à 1.
Respect des NQE
La méthode de calcul pour les dépassement de NQE reprend l’arbre de décision décrit dans le “Guide technique d’évaluation de l’état des eaux de surface continentales” édition mars 2016, p. 34. Les traitements ne portent que sur les substances qui ont une NQE (MA ou CMA) individuelle. Le cas des familles de substances n’est pas traité ici.
Une substance ne respecte pas sa NQE quand la concentration mesurée est supérieure à la NQE MA et/ou la NQE CMA. Une substance est en respect de sa norme NQE quand la NQE MA et la NQE CMA sont respectées. L’état n’est pas connu si la NQE CMA est respectée mais qu’il n’est pas possible de se prononcer pour le respect de la NQE MA.
L’état d’un site est défini de la manière suivante :- lorsque l'une des NQE pour les substances détectées n'est pas respectée, la station est considérée comme étant en mauvais état ;
- lorsque la totalité des NQE pour les substances détectées est respectée, la station est considérée comme étant en bon état ;
- lorsque le respect des NQE n'a pu être déterminé pour l'ensemble des substances détectées, dans ce cas uniquement, l'état de la station est considéré comme étant inconnu.
Les modalités de rapportage fixées au niveau communautaire prévoient une famille « pesticide » qui regroupe treize paramètres. La France a choisi d’ajouter cinq paramètres pour l’évaluation de l’état écologique (polluants spécifiques synthétiques) avec des NQ-MA complémentaires en cours d’eau. Soit 39 substances pesticides en Bretagne (dont 18 herbicides, 12 insecticides, 4 fongicides et 1 molluscicide), dont 13 interdites d’usages en France.
Respect des PNEC
Les traitements ne portent que sur les substances qui ont une PNEC individuelle. Par an, par station et par substance, la concentration moyenne annuelle est calculée par moyenne arithmétique des données. Sur chaque station, seules les substances présentant 4 analyses (>=4) dans l’année sont conservés. Les analyses non quantifiées (RQAnalyse<>1) sont remplacées par la moitié de la valeur de la limite de quantification. Par an, par station et par substance, le rapport à la PNEC est ensuite calculé comme suit : Rapport PNEC = [concentration sub X]/PNEC sub X
Une substance ne respecte pas sa PNEC quand la concentration moyenne calculée est supérieur à la PNEC.
L’état d’un site est défini de la manière suivante :- lorsque qu'au moins une substance dépasse la PNEC, la station est considérée comme étant en mauvais état ;
- lorsque toutes les substances respectent leur PNEC, la station est considérée comme étant en bon état.
- Seuils de restitution par station :
- Accéder aux données
-
- Données ouvertes de l'OEB : Qualité des cours d'eau vis-à-vis des pesticides en Bretagne - Impact sanitaire
Voir aussi
- Tableau de bord : Pesticides - Évolution des concentrations dans les cours d'eau